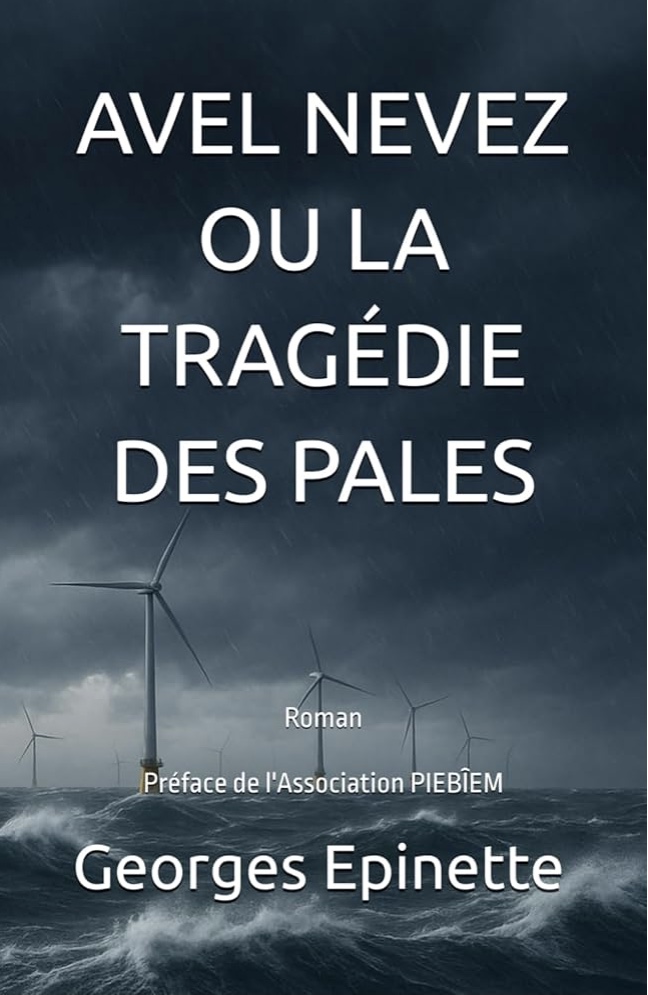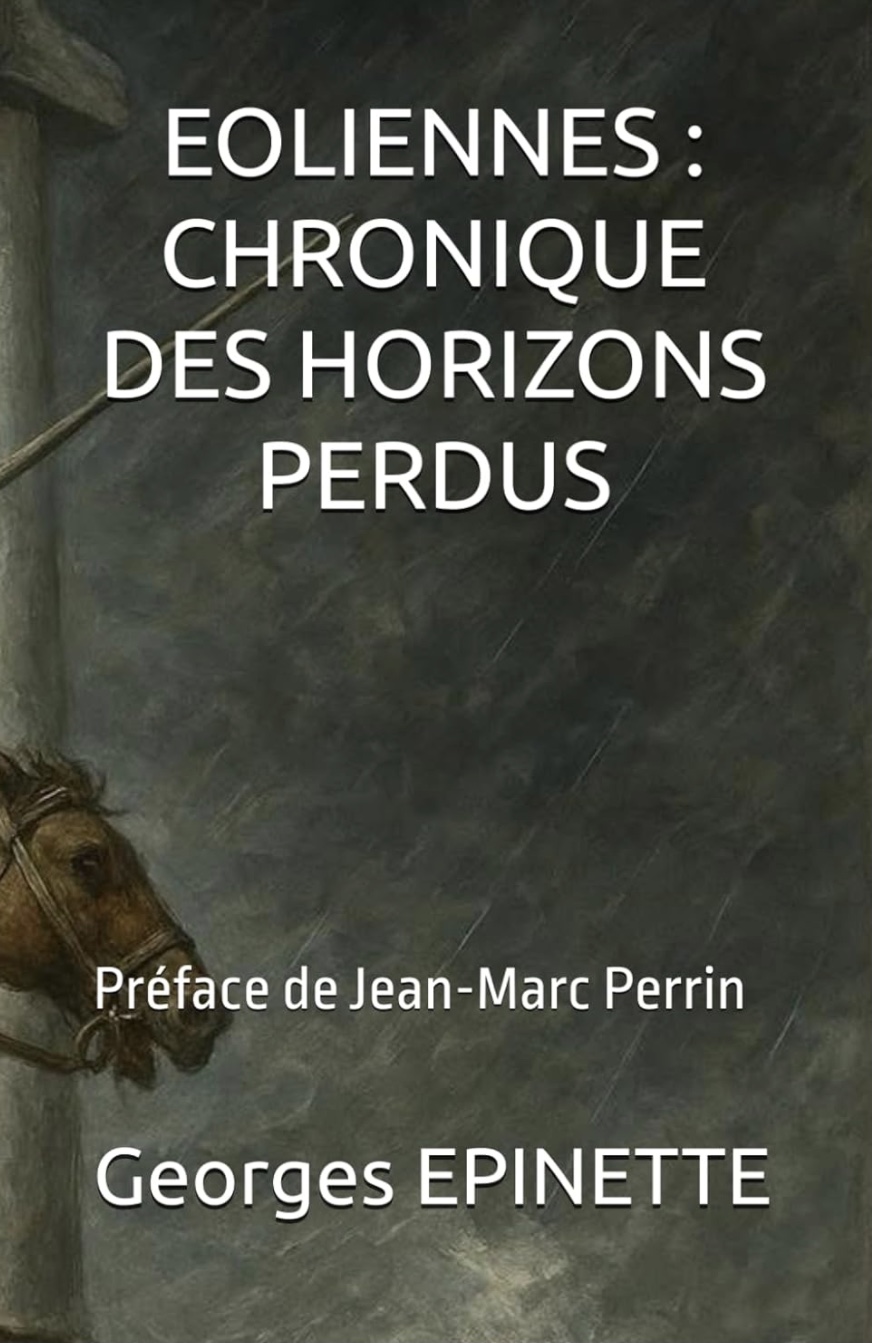mais aussi des romans engagés …
Un livre vous arrive parfois comme ces paquets-cadeaux dont l'emballage trop soigné dit l'importance de ce qu'il recèle. Celui-ci en a tous les attributs : un titre énigmatique, une préface militante, des remerciements discrets et cette épigraphe muette d'une page blanche qui en dit long sur les non-dits à venir. Georges Epinette, d'emblée, installe son lecteur dans l'expectative. Et l'on sent que l'on n'en sortira pas indemne.
« Avel Nevez ou La Tragédie des Pales » est de ces romans qui vous prennent à la gorge par son sujet autant que par sa forme. Une fiction, certes, mais ancrée dans une réalité si brûlante qu'elle en devient presque un document. L'auteur, d'une plume acérée et mélancolique, y explore la fracture moderne entre une écologie théorique, décidée dans les cercles du pouvoir, et une écologie du terrain, vécue par ceux dont le paysage est l'âme. Le projet de parc éolien offshore Avel Nevez, qui doit naître au large de Keriniz, en Bretagne, sert de révélateur à tous les conflits de notre temps : global contre local, technocratie contre démocratie, progrès contre patrimoine.
Epinette ne tombe jamais dans le manichéisme facile. Son héroïne, Léna, est une ingénieure parisienne idéaliste, envoyée en terre bretonne pour superviser le projet. Elle incarne cette génération formée à la logique des chiffres et à la foi dans les transitions vertes, mais qui devra affronter la complexité humaine et la force des silences. Face à elle, Goulven, journaliste local désenchanté, lui oppose la résistance du cynisme et l'amour viscéral d'un patrimoine immatériel : l'horizon, le vent, la mémoire des pierres. Leur rencontre est l'un des grands moments du roman, un duel intellectuel et sentimental où s'affrontent deux conceptions du monde.
Autour d'eux, Epinette dresse une galerie de personnages d'une épaisseur remarquable. Du pêcheur Yann Kermadec, dont la détresse est d'autant plus poignante qu'elle est silencieuse, au maire opportuniste Jean-Pierre Le Goff, en passant par le manipulateur Gilles Tanval et l'archéologue intègre Soazik Le Henaff, chacun porte une part de vérité et d'ambiguïté. L'auteur excelle à montrer comment les grandes causes se brisent sur les petits intérêts, comment les convictions les plus pures cèdent face aux réalités économiques.
La structure du roman, en trois parties (« L'Engouement », « L'Effondrement », « Les Cicatrices »), épouse la chronologie d'un désastre annoncé. De la concertation tronquée aux mensonges d'État, des désastres écologiques immédiats à la guerre civile larvée entre habitants, Epinette démonte pièce par pièce la machine infernale d'un projet qui, sous couvert de vertu, sacrifie l'essentiel sur l'autel de l'urgence climatique. Le chapitre sur les vaches de Kériniz, mortes sans doute des vibrations des travaux, est un morceau de bravoure qui rappelle que le progrès a toujours ses victimes collatérales.
Le style, souvent lyrique, parfois rageur, toujours précis, sert à merveille ce propos désenchanté. L'auteur a une façon de décrire la mer, le vent, la lande, qui les rendent personnages à part entière. Les dialogues sont ciselés, porteurs de cette oralité bretonne qui mêle rudesse et poésie. On sent une colère sourde, contenue, qui donne au texte une puissance rare.
Reste que ce roman n'est pas sans défauts. Son parti pris est si fort qu'il frôle parfois le pamphlet. Les partisans du projet y sont souvent caricaturés en cyniques ou en naïfs, et l'accumulation des catastrophes peut donner l'impression d'un plaidoyer plus que d'une fiction. La préface de l'association PIEBÎEM, si elle éclaire le contexte, ancre peut-être trop l'œuvre dans un combat militant, au risque d'en limiter la portée littéraire.
Mais c'est précisément cette dimension engagée qui fait la force de « Avel Nevez ». Dans la grande tradition du roman à thèse, Georges Epinette nous offre une fable tragique et nécessaire sur les impasses de notre modernité. Il rappelle, comme l'écrivait déjà François Arago, que « dans notre pays, l'absurde ne dure pas ». Encore faut-il avoir le courage de le nommer. Ce roman est un acte de résistance. À lire d'urgence, avant que la fiction ne rejoigne trop cruellement la réalité.
Sous le titre modeste de « chronique », ces pages sont le journal d'une âme qui se regarde douter. L'auteur, Georges Epinette, s'interroge moins sur les éoliennes elles-mêmes que sur le reflet qu'elles renvoient de son propre esprit, partagé entre l'ingénieur et le poète, entre la nécessité du progrès et la mélancolie des horizons perdus.
Ce livre n'est point un essai, mais une longue rêverie devant la fenêtre ouverte sur un paysage transformé. Chaque cahier est une variation sur le thème de la contradiction, une tentative pour habiter le paradoxe sans chercher à le résoudre. L'auteur ne conclut pas ; il se contente d'observer, avec une honnêteté qui touche au tragique, le mouvement circulaire de ses pensées, semblable à celui des pales dans le vent.
On y sent l'influence de ces maîtres du doute que sont Cioran, Pessoa ou Heidegger, non par l'érudition, mais par cette disposition d'esprit qui préfère la question à la réponse, l'ambiguïté à la certitude. L'écriture, souvent belle, se fait tantôt technique, tantôt poétique, comme si l'auteur essayait successivement tous les langages pour dire l'indicible tension entre l'utile et le beau.
Ce qui frappe, finalement, ce n'est pas le sujet apparent – ces géants blancs plantés dans la mer –, mais le paysage intérieur qu'ils révèlent : une conscience déchirée, multiple, qui se regarde se regarder. Le livre est moins une critique des éoliennes qu'une méditation sur l'impossibilité de choisir, sur la grâce fragile du compromis, sur la sagesse qui consiste à accepter de vivre avec ses propres divisions.
Un ouvrage pour ceux qui savent que les grandes questions n'ont pas de réponses, mais que le fait de les poser donne un sens à notre condition paradoxale.
Il est des livres qui vous arrivent comme des épitaphes, murmurant à l'oreille des vérités que l'époque préférerait ignorer. Fragments d'un monde désenchanté : Cinq nouvelles de la condition moderne est de ceux-là. Sous ce titre qui sent la poussière des bibliothèques et l'amertume des lendemains qui déchantent, se cache un recueil qui n'a de modeste que les apparences. L'auteur, qui visiblement cultive l'art du pseudonyme avec la même application qu'il manie la plume, nous offre rien moins qu'une anatomie de notre mélancolie contemporaine.
Cinq récits, cinq variations sur le thème de l'échec et de la résignation, mais surtout cinq portraits d'hommes broyés par des systèmes qu'ils n'ont pas choisis. D'entrée, le ton est donné avec "L'homme qui écrivait trop", véritable ovni littéraire qui tient à la fois du journal intime et du manifeste métaphysique. On y suit les dérives d'un Georges anonyme, hanté par le langage au point d'en perdre le sens des réalités. L'écriture devient ici maladie existentielle, addiction sublime et désespérée.
Viennent ensuite "Les deux morts de Georges Trogoff", élégie douce-amère sur l'ingratitude des hommes envers leurs génies, puis "Sécession et Réconciliation", dystopie voltairienne qui sonde nos divisions politiques avec une ironie mordante. "De l'inutilité des jours" explore quant à lui l'art subtil de l'effacement dans les méandres bureaucratiques, tandis que "Les médiocres" clôt ce cycle par un implacable constat sur la lente asphyxie des idéalistes dans l'éducation nationale.
Ce qui frappe d'emblée, c'est la constance d'une voix - celle d'un moraliste désabusé qui aurait lu trop de Cioran et pas assez de Candide. Le style, souvent virtuose, manie tour à tour la plume du philosophe, celle du sociologue et celle du poète. On sent l'influence des grands désenchantés de la littérature, de Bernanos à Houellebecq, mais avec cette singularité : une tendresse secrète pour ces âmes perdues qu'il décrit avec une précision clinique.
L'ensemble compose une œuvre exigeante, parfois trop, qui ne craint pas les longueurs ni les digressions. Certains passages, notamment dans "L'homme qui écrivait trop", frisent l'auto-indulgence. Mais comment reprocher à l'auteur de se perdre dans les méandres de la langue quand c'est précisément le sujet de son propos ?
Au final, ce recueil s'impose comme le miroir trouble d'une époque qui a perdu ses illusions sans avoir trouvé de raisons d'espérer. On en sort troublé, comme après une longue conversation avec un esprit supérieur qui aurait tout compris, tout pardonné, mais n'en serait que plus désespéré. Œuvre lumineuse et désolée, qui mérite sa place dans le panthéon des classiques de la désillusion moderne.